1. Premier croisement
Examinons les résultats, classiquement,
tout d 'abord
caractère
par caractère.
Faisons l'hypothèse la plus simple : la différence de couleur
du corps est sous la dépendance d'un seul gène A
avec ses allèles a
et a+. Les croisements réalisés peuvent s 'écrire:
P1 X P2 : a / a X a+ / a+ ----> F1 a / a+
le phénotype« corps
gris » de la F1 indique
que le caractère corps noir est récessif.
F1 X D.M : a / a+ X a /a ------> 192+5 = 197 individus à corps
noir et 199+8 = 207 individus à corps gris
Ces résultats ne sont pas significativement différents de
50% / 50% : l 'hypothèse peut être conservée (ficheD).
De même, faisons l 'hypothèse d 'une seule différence
génétique existant entre la souche mutante et la souche de
référence en ce qui concerne la couleur des yeux. Soit B le
gène en cause, avec ses allèles b et b+. Les croisements peuvent
s 'écrire :
P1 X P 2 : b / b X b+ / b+ ---> F1 b / b+
le phénotype « yeux rouge brique » de la F1
indique que le caractère « yeux pourpres » est
récessif.
F1 X D.M. b / b+ X b / b ---> 192+8 = 200 individus à yeux pourpre
et 199 +5= 204 individus à yeux rouge brique
Ces résultats ne sont pas significativement différents de
50% / 50%: l 'hypothèse peut être conservée.
Lorsqu 'on étudie les deux différences phénotypiques à la
fois, on constate qu 'il existe une réassociation des caractères
: les gènes A et B sont donc différents, ce qui permet d 'écrire
les croisements de la manière suivante:
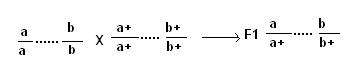
Si les deux gènes sont indépendants, cette
F1 produit 4 catégories de gamètes en fréquence égales :
ab = a+b+ = ab+= a+b ,
Lorsqu'on effectue un croisement avec le DM, producteur de gamètes
ab, les gamètes du double hétérozygote conduisent à 4
types d 'individus en F2 également en fréquences égales,
ab/ab ; a+b+ / ab ; ab+ / ab et a+b / ab
Ce n'est manifestement pas le cas içi : les
individus correspondant à des gamètes parentaux (192 et 199)
sont en nombre nettement plus important que les individus correspondant à des
gamètes de types recombinés ( 8 et 5 ) .
On est donc conduit à faire l 'hypothèse de deux gènes
liés :
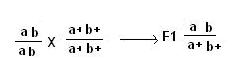
Les gamètes ab et a+b+ ( parentaux) donnent des individus
F2 qui sont respectivement:
ab / a b (de génotype et
de phénotype identiques à ceux
de la souche double mutante)
a+b+ /ab (de génotype et de phénotype identiques à ceux
de la F1)
Les gamètes ab+ et a+b ( recombinés) donnent des individus
F2 qui sont respectivement:
ab+/ ab ( yeux pourpre, corps gris)
a+b/ ab ( yeux rouge brique, corps noir).
La fréquence des gamètes recombinés est facile à calculer:
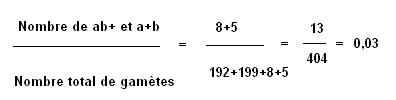
Les deux gènes, repérés par leur mutation respective,
sont donc séparés par 3 centimorgans, puisque, par convention,
une unité de recombinaison est égale à 1% de recombinés.
2. Second croisement
On parle d'un croisement "réciproque". Les résultats
obtenus conduisent à conclure qu 'il
n 'y
a pas de recombinaison chez le mâle
de la drosophile. On doit se souvenir de cette particularité quand on étudie
des croisements de drosophile. Chez cet organisme l'étude de la fréquence
de recombinaison ne peut donc concerner que la méiose des
femelles. Deux notes d'informations importantes vous permettent d'en savoir
plus : 
