Les Biotechnologies industrielles : Contexte et historique
SOMMAIRE
|
|

SOMMAIRE
|
|

Depuis la préhistoire, bien avant la découverte des micro-organismes au milieu du XIXe, l’homme avait une maîtrise étonnante de méthodes purement empiriques pour la préparation d’aliments, de boissons et de vêtements. Les exemples les plus frappants de ces procédés microbiologiques traditionnels sont la fabrication de la bière, du vin, du pain, du vinaigre, du fromage, du beurre et le rouissage du lin.
La naissance de la microbiologie rendit possible une véritable compréhension de ces procédés traditionnels et permit d’améliorer nombre d’entre eux. Elle suscita en outre le développement d’industries entièrement nouvelles reposant sur l’utilisation de micro-organismes qui n’étaient pas encore exploités par l’homme. Les nouvelles utilisations des micro-organismes comprennent la fabrication à l’échelle industrielle d’acide lactique, d’acide citrique, d’acétone et d’alcool butylique, de vitamines et d’antibiotiques.
 , le pain
, le pain 
La fabrication et la consommation de boissons alcoolisées étaient déjà connues dans les plus anciennes civilisations dont on ait la trace. Dans la plupart de ces civilisations, l’origine de la fabrication de la bière ou du vin était mythique et sa découverte attribuée à une révélation divine. Le Tibet fait exception, le roi Srong-btsan Sgam-po n’ayant introduit la bière et l’eau-de-vie que vers 640, en même temps qu’il importait d’Inde et de Chine l’art de la poterie, de l’irrigation (pour cultiver l’orge), le papier et l’encre.
Les boissons fermentées se rangent en deux grandes catégories qui diffèrent par la nature de la matière première utilisée et par la technique de préparation. Le vin est fait de jus de raisins ; on peut également laisser fermenter le jus d’autres fruits. La bière est préparée à partir de grains. Dans les deux cas, c’est la levure de bière (Saccharomyces cerevisiae) qui est responsable de la fermentation alcoolique  .
.
La différence essentielle tient à la nature des sucres : les jus de fruits contiennent des sucres solubles directement utilisables par les levures qui effectuent la fermentation alcoolique alors que celles-ci ne peuvent pas utiliser l’amidon des grains. La préparation de la bière comporte donc une étape préalable où l’amidon des grains est hydrolysé en sucres solubles par des enzymes d’autres provenances. Les trois grandes sortes de grains utilisées traditionnellement pour la fabrication de boissons sont l’orge, le riz et le maïs. Le procédé conduisant à l’hydrolyse de l’amidon est adapté à chaque sorte de grain. Dans le premier cas, la transformation de l’amidon en sucres solubles se réalise spontanément au moment de la germination de l’orge. Pour le riz, l’hydrolyse est effectuée par une moisissure se développant sur le riz cuit, la levure de bière transformant au fur et à mesure les sucres solubles en alcool. Les Indiens d’Amérique Centrale et du Sud préparent une sorte de bière de maïs en mâchant les grains et en recrachant le mélange dans un récipient où il fermente spontanément. Dans ce cas, ce sont les enzymes de la salive qui hydrolysent l’amidon.
Toutes les levures utilisées appartiennent à l’espèce Saccharomyces cerevisiae, mais toutes les souches ne peuvent pas faire une bière buvable. Les souches spéciales possédant les propriétés désirables en brasserie ont été progressivement sélectionnées. La réussite d’un brasseur dépend en grande partie de son aptitude à obtenir une souche ad hoc et à la transmettre d’une cuve à l’autre sans contaminations excessives. De bonnes levures de bière furent ainsi obtenues par un processus de sélection inconsciente au cours de centaines d’années ; elles ne se trouvent pas dans la nature comme de bonnes levures à vin. Les levures de bière sont un produit du savoir-faire de l’homme, comme les plantes cultivées.
Le second usage principal de la levure, son emploi comme levain, est une découverte plus récente. Elle semble être née il y a 6 000 ans environ en Egypte d’où elle s’est répandue lentement dans les autres parties du monde occidental. Il est certains que les Grecs ne connaissaient pas la fabrication du pain, jusque vers l’an 600 avant JC ; Pline écrivant au début de l’ère chrétienne affirme que les Romains se nourrirent longtemps de bouillie et non de pain. Une fermentation alcoolique provoquée par des levures est une étape essentielle de la fabrication du pain : elle permet de faire lever la pâte (d’où les mots « levure », « levain »). La farine elle-même ne contient que peu de sucres libres, mais elle contient suffisamment d’enzymes hydrolysant l’amidon pour produire un peu de sucre pendant que le pain lève. Le sucre est rapidement fermenté par les levures avec production d’alcool et de CO2, ce dernier faisant gonfler la pâte. Pendant la cuisson, l’alcool s’évapore. La levure produit aussi d’autres changements plus subtils auxquels on doit le bon goût du pain. Les levures de boulangerie appartiennent toutes à l’espèce Saccharomyces cerevisiae et proviennent historiquement de souches de levures utilisées en brasseries. Jusqu’au XIXe siècle, la fabrication du pain se faisait soit à domicile, soit dans de petites boulangeries et la levure nécessaire venait de la brasserie la plus proche. La production commerciale de levure comprimée destinée à la boulangerie commença vers 1850, avec le développement des grandes boulangeries (il faut 5 kg de levure pour 300 kg de farine).
L’alcool éthylique est un produit chimique industriel très important. La plus grande partie est obtenue par la distillation de substances végétales fermentées. Les problèmes économiques de la production d’alcool industriel sont très différents de ceux de la production de vin ou de bière. Dans le premier cas, le coût de la matière première est un facteur primordial (pomme de terre et betterave en Europe, mélasse des Antilles aux USA). Des souches spéciales de levures ont été sélectionnées pour la production industrielle d’alcool avec ces matières premières. Elles proviennent historiquement des levures utilisées en brasserie, mais depuis le XVIIIe siècle, elles ont été spécialement sélectionnées en vue d’une culture rapide et d’une forte production d’alcool. Aujourd’hui, les souches de levure des distillateurs ont des propriétés totalement différentes de celles utilisées en brasserie.
Les besoins de l’industrie chimique au cours de la Première Guerre ont conduit à la création d’une nouvelle industrie des fermentations. La production par fermentation d’acétone et de butanol, contrairement à celle du glycérol, continua après la guerre en grande partie parce que le butanol trouva des utilisations industrielles croissantes. Cette production d’acétone et de butanol fut le premier processus microbiologique à grande échelle dans lequel la contamination posa de sérieux problèmes. Les conditions optimales du développement de Clostridium acetobutylicum sont aussi très favorables au développement des bactéries lactiques, et si ces dernières commencent à se développer, elles inhibent rapidement Clostridium acetobutylicum en formant de l’acide lactique. La contamination des bactéries par des virus qui détruisent les cultures pose un autre problème. Par conséquent, la production par fermentation d’acétone et de butanol peut réussir seulement dans des conditions de culture plus soigneusement contrôlées que celles utilisées pour la production industrielle d’alcool éthylique. Cette nouvelle industrie microbiologique inaugura des méthodes de culture pure à grande échelle, qui furent plus tard améliorées lors de la production industrielle de pénicilline. Elles ont été la première étape de l’essor des biotechnologies.
 Moonshine still circa 1930s. Image credit:OldPicture
Moonshine still circa 1930s. Image credit:OldPicture
Le développement industriel de la production de pénicilline aux USA, pendant la dernière guerre, posa un problème technologique très ardu. Dans les fermentations industrielles, le produit final intéressant avait toujours été un produit métabolique microbien produit en quantité importante. Au contraire, la pénicilline est essentiellement un sous-produit métabolique des champignons qui la produisent. Au début des travaux sur la pénicilline, la concentration finale dans le milieu de culture n’excédait pas 0,01 %. De nombreux laboratoires s’attaquèrent donc immédiatement à deux aspects purement microbiologiques du problème : l’étude de milieux qui donneraient de plus fortes productions de pénicilline et l’isolement de nouvelles souches à partir du sol ou par mutagenèse. Grâce à cela, le rendement de la production de pénicilline fut largement centuplé en quelques années. Aussitôt que la production de pénicilline commença à grande échelle une autre série de difficultés technologiques surgit. La pénicilline est chimiquement instable et par conséquent sa récupération à partir de cultures puis sa purification et enfin sa stérilisation et sa conservation posèrent des problèmes particuliers aux ingénieurs chimistes. Pis encore, la pénicilline est rapidement détruite par une enzyme spécifique produite par de nombreuses bactéries. Par conséquent les méthodes de culture pure les plus rigoureuses sont absolument nécessaires pour sa production. Il est assez simple de maintenir une culture pure en laboratoire, dans une fiole de verre, mais dans une cuve métallique de 40 000 litres, le maintien de conditions de culture pure soulève une nouvelle série de problèmes techniques qui n’avaient pas encore été complètement résolus au cours du développement de l’industrie de la production par fermentation de l’acétone et du butanol. Il était absolument indispensable de les résoudre avant d’installer une industrie de la pénicilline. On y parvint finalement grâce à l’ingéniosité des microbiologistes et des ingénieurs. La réussite de l’établissement de l’industrie de la pénicilline aux USA, entre 1940 et 1943, représente l’une des œuvres les plus impressionnantes des biotechnologies. Tous les problèmes techniques majeurs ont été résolus à cette occasion et le développement commercial des autres antibiotiques n’a pas impliqué de principes nouveaux.


Molécule de pénicilline Unité de fermentation pour purifier la péniciline en 1945
Photograph courtesy of Merck Archives, ©Merck & Co. Inc.
La surpro20 mai, 2010;nétiquement modifiés eut un impact dans la vie quotidienne, il suffit pour s’en rendre compte de penser aux lessives aux enzymes. Un autre progrès, pour l’industrie des fermentations, fut l’utilisation d’enzymes ou de cellules entières entièrement immobilisées, permettant par exemple de faire de la bière en continu. Cependant, ce sont plus les progrès dans la fabrication et la conduite des fermenteurs industriels qui améliorèrent de façon spectaculaire la production et l’utilisation des enzymes qu’une véritable percée en biologie moléculaire.
Le chiffre d'affaire mondial des biotechnologies blanches est évalué actuellement à plus de 50 milliards d'euros et les estimations chiffre son augmentation à environ 300 milliards d'euros d'ici 2015. Lorsqu'on ramène la production scientifique et industrielle au nombre d'habitants, le leader mondial est le Danemark.
La priorité technologique mondiale est l'optimisation des procédés afin que les matières premières issues des biotechnologies puisse concurrencer les produits dérivés du pétrole dans l'industrie chimique.

La production de biocarburants devrait représenter la majeur partie du marché des biotechnologies blanches. Les pays leaders sont les Etats-Unis, le Canada, le Japon et le Brésil. En Europe, la recherche et l'innovation sont surtout développées en Allemagne et en France.
Le Canada est le pionnier du concept de bio-raffinerie et le Brésil est le premier producteur mondial de biocarburants. Si la priorité donnée aux biocarburants n'est pas remise en cause sous la pression de l'opinion publique (voir le débat fuel versus food), les biotechnologies devraient produire en 2030 aux Etats-Unis 20% des carburants et remplacer un quart des produits issus actuellement de la pétrochimie. Dans tous les cas, l'objectif mis en avant est l'indépendance économique vis-à-vis des énergies fossiles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La production de biocarburants à base d'éthanol se présente différemment au Brésil et aux Etats-Unis.
Au brésil, l'éthanol est produit à partir du sucre de la canne à sucre ![]()
alors qu'il est produit à partir de l'amidon de maïs aux Etats-Unis  .
.
Au Brésil, le coût de production est compétitif face au pétrole car la production de sucre à l' hectare est très élevée et que les déchets de canne à sucre (la bagasse) sont brûlés dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité. Alors qu'aux Etats-Unis, la production d'éthanol doit être subventionnée. Les aides publiques en faveur du maïs dédié à la production d'éthanol ont provoqué une augmentation rapide des prix (le prix du maïs à la bourse de Chicago a doublé en dix huit mois).
Une autre différence vient de la taille du marché intérieur et de la réserve foncière. Le brésil est d'ores et déjà très largement exportateur malgré le dynamisme du marché intérieur (les véhicules pouvant consommer indifféremment du pétrole ou de l'éthanol repésentent plus de la moitié du marché) alors que 1% seulement des terres cultivables sont utilisées pour la canne à sucre. Alors qu'aux Etats-Unis, la demande en carburant étant beaucoup plus importante et les terres arables non utilisées beaucoup plus restreintes. Une production importante d'éthanol aux Etats-Unis n'est envisageable qu'à partir de cellulose ou d'autres déchets agricoles (ce qu'on appelle les biocarburants de"seconde génération").
Enfin, si on aborde le problème des biocarburants sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, il faut noter que la production d'éthanol à partir de la canne à sucre est la seule à avoir un bilan franchement positif.
Il faut noter que le Japon qui a été le premier pays à adopter les biotechnologies industrielles, ne dispose pas de surfaces suffisantes pour répondre à la demande nationale en carburants.

Parmi les treize sociétés de biotechnologies françaises cotées en bourse, une seule (Metabolic Explorer) se consacre aux biotechnologies blanches. Toutes les autres travaillent dans le secteur pharmacie-santé.
Après la pharmacie et l'agronomie, les biotechnologies débarquent dans l'industrie. Les entreprises françaises ne saisissent pas encore ce potentiel.
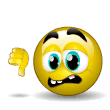
En France, l'effort en matière de biotechnologies blanches reste marginal pour la chimie fine et les biomatériaux. C'est la santé qui capte les fonds (voir ci-dessous l'article de Mathieu Quiret dans le journal Les Echos n° 19661 du 05 Mai 2006 • page 11).
Après avoir manqué le virage des biotechnologies pharmaceutiques et agronomiques, la France va-t-elle passer à côté de la révolution des biotechnologies blanches, celles destinées à l'industrie ? Le programme biohub, que l'Agence pour l'innovation industrielle (AII, « Les Echos » du 4 mai 2006) vient de lancer sur l'amidon, redonne certes une lueur d'espoir aux chercheurs français. « Cela pourrait créer un effet d'affichage », espère Pierre Monsan, expert à l'Insa Toulouse. L'impulsion donnée aux biocarburants par le gouvernement actuel depuis quelques mois incite également à l'optimisme.
Pour autant, les exemples étrangers montrent que la recherche académique et industrielle française est à la traîne. En Allemagne, dans les pays du Nord, en Amérique, de grandes entreprises investissent massivement dans le domaine de la chimie, de l'énergie ou des matériaux. L'enjeu est tout simplement de transformer la pétrochimie en biochimie, de passer d'une source fossile de molécules carbonées à une source végétale, durable et sans effet de serre. A l'instar des efforts de recherche sur les biocarburants, le secteur de l'agrochimie espère détrôner les pétroliers pour fournir les synthons de base à des secteurs très variés, comme les cosméticiens, les producteurs de plastiques, de solvants, de peintures, etc.
Les Etats-Unis se mobilisent à coups de centaines de millions de dollars pour réduire leur dépendance au pétrole. Au Brésil, l'exploitation massive de la canne à sucre est en train de déboucher sur une véritable biochimie de l'éthylène, une molécule majeure de l'industrie. Le Canada est devenu le pionnier du concept de bioraffinerie. En Italie, Novamont commercialise de longue date un polymère contenant 50 % d'amidon, le Mater-bi. Aux Pays-Bas, c'est DSM qui mène le bal. En Allemagne, BASF fait également preuve de dynamisme.
Et les avancées se concrétisent. L'américain Dupont démarre cette année une usine de production de fibres textiles tirées du maïs. Ce polymère est produit par voie chimique à partir du monomère 1,3 propanediol, lui-même obtenu par des bactéries transgéniques conçues via les biotechnologies. Cette prouesse scientifique a consisté à transférer les gènes qui produisent les enzymes de production du monomère dans un organisme facile à élever en condition industrielle.
Une autre technologie de bioplastiques fait une remarquable percée : les PLA tirés de la fermentation de l'amidon. Initialement destinés à des applications médicales, ces polyesters polylactiques se déclinent aujourd'hui en films, objets moulés ou fibres textiles.
Les progrès peuvent être plus « incrémentaux ». Au Danemark, la société Danisco a réussi récemment à remplacer dans l'un de ses plastiques le phtalate par un substitut tiré de lipides végétaux. Cette charge stabilisant les polymères avait l'inconvénient d'être toxique, ce qui posait problème dans les jouets pour enfants notamment.
Pendant ce temps, les industriels français investissent timidement. Le chimiste Arkema finance quelques recherches dans le domaine et plusieurs PME innovantes tentent de jouer les lièvres. C'est en particulier le cas d'ARD, le dynamique centre de recherche du groupe Champagne Céréales. Localisé sur le site agro-industriel de Bazancourt, il cherche à valoriser les produits de la sucrerie Cristal Union et de l'amidonnier Chamtor. D'autres firmes françaises ont totalement loupé le coche. C'est le cas du chimiste Rhodia par exemple, qui se mord encore les doigts d'avoir vendu ses biotechnologies de fermentation en cédant sa filiale Rhodia Food à Danisco.
Le nouveau panorama 2006 publié par l'association France Biotech confirme la modestie de l'effort français. Pour le moment, l'essentiel des biotechnologies blanches est investi dans le secteur des cosmétiques, qui compte 40 entreprises dans ce domaine. A contrario, seules 12 sociétés biotechnologiques ont investi dans l'alimentation et 16 travaillent pour l'environnement ou l'industrie. Dans ces applications, les technologies de contrôle et de traçabilité dominent alors que la chimie fine, les biomatériaux ou le traitement des déchets restent marginaux.
Les choses avancent pourtant en France, notamment à travers les pôles de compétitivité. Le pôle de Rhône-Alpes  consacré aux bioressources cherche en particulier à valoriser la glycérine, un sous-produit de la production de biodiesel, dans le cadre d'un projet européen. Ses acteurs préparent aussi un programme régional d'une vingtaine de millions d'euros sur quatre ans. Il porterait notamment sur le traitement des eaux ou l'intensification des procédés industriels. Du côté des laboratoires publics, quelques équipes trop rares tirent leur épingle du jeu. Quant à l'Agence nationale pour la recherche, elle finance depuis 2005 quelques études sur la production de biocarburants par biotechnologies. Elle vient aussi d'ouvrir deux nouveaux appels d'offres sur la valorisation de ces technologies.
consacré aux bioressources cherche en particulier à valoriser la glycérine, un sous-produit de la production de biodiesel, dans le cadre d'un projet européen. Ses acteurs préparent aussi un programme régional d'une vingtaine de millions d'euros sur quatre ans. Il porterait notamment sur le traitement des eaux ou l'intensification des procédés industriels. Du côté des laboratoires publics, quelques équipes trop rares tirent leur épingle du jeu. Quant à l'Agence nationale pour la recherche, elle finance depuis 2005 quelques études sur la production de biocarburants par biotechnologies. Elle vient aussi d'ouvrir deux nouveaux appels d'offres sur la valorisation de ces technologies.
C'est maintenant aux industriels français de s'emparer du sujet et d'en apprécier toutes les potentialités. Les biotechnologies blanches ont toutes les raisons de percer en France. Car, contrairement aux biotechnologies agricoles qui essaiment dans la nature, les micro-OGM impliqués dans les nouveaux procédés restent confinés en cuves, comme dans le cas des biotechnologies pharmaceutiques. L'industrie n'affrontera donc pas la diabolisation des OGM par le public français. Même si les biotechnologies blanches auraient tout à gagner à utiliser des céréales ou des oléagineux génétiquement modifiés pour contenir plus d'amidon ou de produits valorisables. Les Américains travaillent déjà sur cette prochaine étape.



© Université
de TOURS - GÉNET
Document modifié le
20 mai, 2010