La répétition a une grande vertu pédagogique...espérons-le : encore
une fois, il ne faut pas se précipiter, et il est nécessaire
de respecter le protocole exposé plusieurs fois. C'est
pourquoi l'analyse de la F2 se déroulera en 2 étapes:
Analyse caractère par caractère
Analyse simultanée des deux couples d 'allèles.
Mise en évidence de la réassociation des
caractères:
Les résultats de F1 montrent que le caractère mutant [yeux
marrons] est récessif
ainsi que le caractère mutant [ailes courtes].
Les résultats de la F2 montrent que les caractères
associés dans les souches P1 [ yeux marrons, ailes longues] et P2
[ yeux rouge sombre, ailes courtes ] peuvent être recombinés
dans certains descendants.
Analyse de la F1:
Analyse caractère par caractère:
Si la différence phénotypique (couleur
de l'oeil) est sous le contrôle
d 'un seul couple d'allèles, les croisements et les divers individus
s 'écrivent de la manière suivante ( ) :
) :
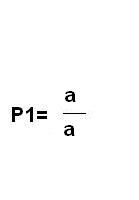
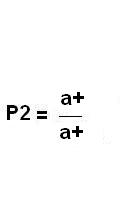
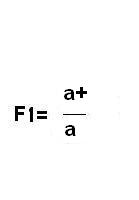

Comme nous l 'avons vu dans la fiche 47 (figure1) on s 'attend alors à obtenir
deux types d 'individus en quantités égales,
soit donc, en théorie 500 à yeux marrons et 500 à yeux
rouge sombre. Le calcul du c2 montre que l 'on
peut conserver l 'hypothèse
(ficheD): la différence de caractère concernant
la couleur de l' oeil est sous la dépendance d 'un seul couple d 'allèles
que l'on notera a,a+.
Si la différence phénotypique (longueur des ailes) est sous
le controle d 'un
seul couple d 'allèles, on peut écrire les croisements et les
divers individus de la manière suivante :
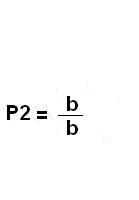
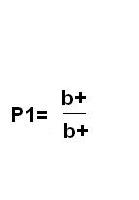

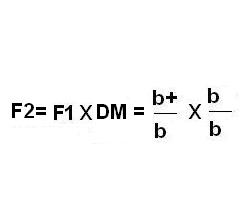
Comme nous l 'avions vu dans la fiche 47, (figure1) on s 'attend à obtenir
deux types d 'individus en quantités égales,
soit donc, en théorie 500 à ailes courtes et 500 à ailes
longues. Le calcul du c2 montre que l 'on
peut conserver l 'hypothèse
(ficheD): la difference de caractère concernant la
longueur des ailes est sous la dépendance d 'un seul couple d 'allèles
que l'on notera b, b+.
Ainsi donc dans le cas qui nous interesse ici, on envisage que deux couples
d'allèles correspondent respectivement aux deux differences phénotypiques
observées.
Redisons, en insistant , que ce n 'est pas toujours le cas ( ).
).
Analyse simultanée des 2 couples d'allèles
Nous pouvons maintenant écrire le génotype complet
des deux souches et de la F1, en admettant que les deux gènes sont
situés sur des chromosomes differents,
comme cela est le plus probable ( ).
).
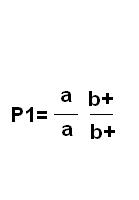
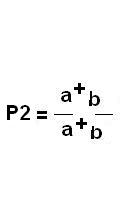
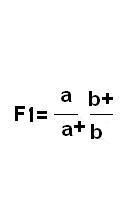
D'après ce que nous avons vu chez la levure, les méioses d 'un
tel diploïde donnent
4 types de produits, en proportions équivalentes: ab+ = a+b = ab =
a+b+
La rencontre de ces 4 types de gamètes avec
les gamètes ab produits par le double mutant donne 4 types de diploides, « parentaux » (
P1 et P2 ) ou « recombinés » (R1 et R2) pour
lequels compte tenu de la dominance et
de la récessivité des
caractères, tout se passe comme si l 'apport des gamètes a
b « ne servait à rien ».
 de phénotype oeil marron,
ailes longues signale un gamète a b+ (P1).
de phénotype oeil marron,
ailes longues signale un gamète a b+ (P1).
 de phénotype oeil rouge
sombre, ailes courtes signale un gamète a+b (P2).
de phénotype oeil rouge
sombre, ailes courtes signale un gamète a+b (P2).
 de phénotype oeil marron,
ailes courtes signale un gamète a b (R1).
de phénotype oeil marron,
ailes courtes signale un gamète a b (R1).
 de phénotype oeil rouge
sombre ailes longues signale un gamète a+ b+ (R2).
de phénotype oeil rouge
sombre ailes longues signale un gamète a+ b+ (R2).
De manière assez spectaculaire, le dénombrement des individus
F2 permet donc, encore ici, d 'étudier les proportions des gamètes
de la F1, même si c 'est de manière indirecte.
Les mêmes propositions que celles vues chez la levure (fiche50) peuvent ètre énoncées
: lorsque deux génes sont situés sur deux chromosomes
différents, les 4 catégories parentales et recombinées
sont en quantités égales ce qui conduit à 50%
de recombinés.
Analyse de la F2
Analyse caractère par caractère:
Compte-tenu de la récessivité de chacun des caractères
mutants (voir plus haut ) et du croisement réalisé, on s'attend à obtenir
3/4 d 'individus à yeux rouge sombre et 1/4 d 'individus à yeux
marrons si un seul gène est en cause (figure1) :
Les
nombres observés (734 et 266) ne sont pas significativement
différents des nombres théoriques attendus (750 et 250).
L 'hypothèse d 'une seule différence génétique
peut donc être conservée pour la coloration de l'oeil. On notera
a,a+ le couple d'allèle concerné.
On peut aussi donc conserver l 'hypothèse d' un seul couple d 'allèles
responsable de la deuxième différence phénotypique étudiée
ici, la taille des ailes. Nous le nommerons b / b+.
Analyse simultanée des deux couples d 'allèles
L'hypothèse de 2 gènes
permet d 'écrire le génotype des deux souches, de la F1 et de
la F2 (F1xF1).
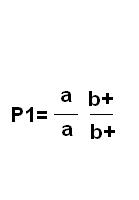
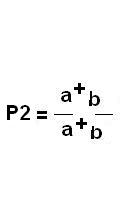
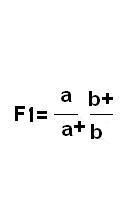
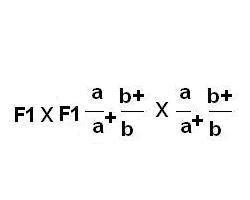
Dans l 'hypothèse de gènes situés sur des chromosomes
différents, 4 catégories de gamètes
sont produits par les individus F1, avec des fréquences égales
(figure2) .
Il y a 16 possibilités de rencontre des gamètes qui donnent
9 types différents de génotypes, car certaines rencontres de
gamètes donnent le même génotype diploïde (figure3):
Compte-tenu de la récessivité des deux caractères mutants étudiés
ici, les phénotypes différents sont au nombre de quatre.
Les 4 génotypes du groupe I donnent les yeux rouge sombre et les ailes
longues ; les 2 génotypes du groupe II donnent les yeux marrons
et les ailes longues ; les 2 génotypes du groupe III donnent
les yeux rouges sombre et les ailes courtes ; le génotype du
groupe IV donne les yeux marrons et les ailes courtes ( ).
).
Dans l 'hypothèse de génes situés sur des chromosomes
différents, les quatre catégories de gamètes sont équiprobables.
Les 16 possibilités de rencontre des gamètes le sont également.
Dans ce cas (figure4)
on s'attend donc à observer 9/16 ème
de mouches à yeux rouges sombres et ailes longues (1000X 9/16 = 562,5)
3/16 ème de mouches à yeux marrons et à ailes longues
(1000 X 3/16= 187,5) 3/16 ème de mouches à yeux rouge sombre
et ailes courtes (187,5) et 1/16 ème de mouches à yeux marrons
et à ailes courtes (1000 X 1/16= 62,5).
La comparaison de ces nombres théoriques (562,5 ; 187,5 ;
187,5 ; 62,5) et des nombres observés (respectivement 548 ;
186 ; 194 ; 72) par un test du c2 montre que l 'hypothèse que
nous avons faite peut être conservée : rien ne s' oppose à ce
que les deux gènes (A avec ses allèles a et a+ ; B avec ses
allèles
b et b+) soient situés sur des chromosomes différents.
4 catégories en quantité égales et frequence de
recombinaison inter-chromosomique
De manière quasi directe ( F1 X DM) on retrouve les mêmes conclusions
que chez la levure (fiche50) :
Lorsqu'un croisement met en jeu deux coupls d'allèles situés
sur des chomosomes différents, les produits de la méiose forment
quatre catégories génétiques en quantités égales à 25
% (aux variations statistiques près) : ab+ = a+b = ab=a+b+.
On peut calculer la fréquence de recombinés : ici R1
= 249 R2 = 257, d'ou une fréquence de 506/1000, non statistiquement
différente de 0,50. On peut donc conclure que les deux gènes étudiés
se comportent de manière indépendante et sont donc probablement
( ) sur deux chromosomes
différents.
) sur deux chromosomes
différents.
Et les proportions 9 3 3 1 que l'on observe en F2 sont en réalité le
reflet indirect de l'égalité des catégories de gamètes
produits par la méiose, provoquée par la localisation des gènes
sur des chromosomes différents.